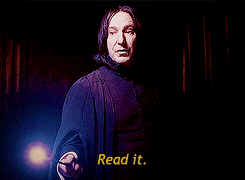Sur la traduction, de Paul Ricœur
(Bayard, 2004)
Cette réflexion sur la traduction se réclame de deux références :
- L’Épreuve de l’étranger d’Antoine Berman[1]
- Le travail de Freud sur le sens du mot travail
La première nous conduit à envisager l’exercice de traduction comme une mise à l’épreuve condamnant le traducteur à un éternel entre-deux et la deuxième permet d’utiliser les notions de travail de mémoire et travail de deuil.
–
–
I. Défi et bonheur de la traduction
> Le travail de mémoire
La traduction est un travail de mémoire car le traducteur, en tant que médiateur, doit servir à la fois « l’étranger » (l’œuvre originale, l’auteur, la langue de départ) et le lecteur destinataire. Face à ce double enjeu, certains ont tendance à sacraliser leur langue maternelle et leur propre culture aux dépends de l’œuvre originale. Cette attitude est dangereuse car elle mène à l’ethnocentrisme linguistique et à l’hégémonie culturelle, c’est-à-dire qu’une langue (ou une culture) devient dominante par rapport aux autres, comme ce fut le cas de la langue française à l’âge classique ou de la langue anglaise de nos jours.
Mais ce refus ou cet échec de la médiation de l’étranger est parfois dû à la difficulté d’arracher le texte de départ à son environnement linguistique et culturel pour le transposer dans un autre. En effet, les multiples systèmes linguistiques  reposent sur des découpages phonétiques, conceptuels ou syntaxiques différents. D’une langue à l’autre, les champs sémantiques ne sont pas exactement superposables, les tournures de phrases ne véhiculent pas les mêmes héritages culturels ou les mêmes connotations et la manière de découper le réel et de le recomposer dans le discours varie. Pour toutes ces raisons, une bonne traduction reste un fantasme irréalisable.
reposent sur des découpages phonétiques, conceptuels ou syntaxiques différents. D’une langue à l’autre, les champs sémantiques ne sont pas exactement superposables, les tournures de phrases ne véhiculent pas les mêmes héritages culturels ou les mêmes connotations et la manière de découper le réel et de le recomposer dans le discours varie. Pour toutes ces raisons, une bonne traduction reste un fantasme irréalisable.
–
> Le travail de deuil
D’où la nécessité de la part du traducteur de faire un travail de deuil et de renoncer à l’idéal de la traduction parfaite. Bien souvent, la traduction comprend trois étapes : l’angoisse de se mettre à la tâche, la lutte avec le texte et enfin l’insatisfaction devant le travail achevé. La tendance à la retraduction incessante des grandes œuvres témoigne effectivement de cette éternelle insatisfaction à l’égard des traductions existantes. Les traducteurs rêvent d’une rationalité qui serait libérée de toutes contraintes culturelles et toutes limitations communautaires.
Dans La Tâche du traducteur, Walter Benjamin parle de cette recherche du pur langage qui permettrait de traduire sans aucune perte. Seulement cela n’existe pas. Le seul moyen d’éprouver le bonheur de la traduction est alors de consentir à cette perte inévitable et de ne pas vou loir combler l’écart entre équivalence et adéquation. Car une bonne traduction ne peut viser qu’à une équivalence présumée et non fondée. Cet exercice reste une entreprise d’approximation dans laquelle le traducteur, aussi fidèle soit-il, est inévitablement amené à trahir l’un ou l’autre de ses maîtres, l’auteur ou le lecteur. Il lui faut donc reconnaître et accepter la différence indépassable qui sépare le propre de l’étranger et, à cet égard, faire preuve d’hospitalité langagière en accueillant chez soi la parole de l’étranger. Ce n’est que par ce travail de deuil et cette hospitalité langagière que le traducteur connaîtra le bonheur de la traduction.
loir combler l’écart entre équivalence et adéquation. Car une bonne traduction ne peut viser qu’à une équivalence présumée et non fondée. Cet exercice reste une entreprise d’approximation dans laquelle le traducteur, aussi fidèle soit-il, est inévitablement amené à trahir l’un ou l’autre de ses maîtres, l’auteur ou le lecteur. Il lui faut donc reconnaître et accepter la différence indépassable qui sépare le propre de l’étranger et, à cet égard, faire preuve d’hospitalité langagière en accueillant chez soi la parole de l’étranger. Ce n’est que par ce travail de deuil et cette hospitalité langagière que le traducteur connaîtra le bonheur de la traduction.
–
–
II. Le paradigme de la traduction
> La traduction entre les langues
Pour Antoine Berman, ce rapport du propre à l’étranger constitue l’essence de la traduction. On considère ici l’exercice au sens strict comme le transfert d’un message verbal d’une langue dans une autre. La traduction existe car les hommes parlent différentes langues. L’origine de cette diversité linguistique remonte au célèbre mythe de Babel, épisode marquant la disparition d’une présumée langue paradisiaque parlée par tous les hommes. Pour certains, il n’a engendré que dispersion et confusion. Mais loin d’être une catastrophe linguistique, la multiplicité des langues est l’origine de la traduction. Grâce à la capacité de tout être humain d’apprendre d’autres langues que la sienne, un après-Babel est possible.
On peut bien sûr envisager deux cas de figure : ou bien l’hétérogénéité des langues est radicale, auquel cas la traduction est impossible, ou bien il existe un fonds commun à ces langues qui rend l’exercice de traduction possible. Puisque la traduction existe aujourd’hui, il faut bien qu’elle soit possible, mais il ne faut pas pour autant considérer la tâche du traducteur comme une contrainte imposée par Babel.
Il s’agit plutôt d’une chose à faire pour que l’action humaine puisse continuer. Au-delà de l’idée de contrainte et d’utilité, Berman insiste ainsi sur le « désir » de traduire du traducteur qui, par cet exercice, élargit l’horizon de sa propre langue. Car comme l’écrit Hölderlin : « ce qui est propre doit être aussi bien appris que ce qui est étranger ».
Malheureusement, même avec toutes les connaissances du monde, le désir du traducteur se heurte au dilemme inévitable de la fidélité et de la trahison, dilemme que Schleiermacher résume par le choix entre « amener le lecteur à l’auteur » et « amener l’auteur au lecteur ». Servir deux maîtres contraint le traducteur à trahir les deux, sauf s’il recourt à l’hospitalité langagière (dont nous avons déjà parlé).
–
> La traduction intralinguistique
 Une autre approche de la traduction propose un sens plus large selon lequel traduire consiste à interpréter tout ensemble signifiant à l’intérieur de la même communauté linguistique. Il ne s’agit donc plus là de passer d’une langue à une autre mais de dire la même chose autrement au sein d’une même langue. Car, selon George Steiner, « comprendre, c’est traduire. »[2]
Une autre approche de la traduction propose un sens plus large selon lequel traduire consiste à interpréter tout ensemble signifiant à l’intérieur de la même communauté linguistique. Il ne s’agit donc plus là de passer d’une langue à une autre mais de dire la même chose autrement au sein d’une même langue. Car, selon George Steiner, « comprendre, c’est traduire. »[2]
Ainsi, nous traduisons tous dès que nous interprétons des paroles. La traduction n’est plus la simple intériorisation du rapport à l’étranger, mais une exploration qui dévoile les procédés quotidiens d’une langue vivante. Cette exploration est justifiée par la propension de tout langage à l’énigme, au secret et à la non-communication. Même au cœur de notre propre langue, il existe une part d’indicible et d’intraduisible. Aussi intéressante soit cette deuxième conception de la traduction, on se réfère plus souvent à la première.
–
–
Récapitulons…
La traduction est donc un travail de mémoire, puisque le traducteur sert à la fois le propre et l’étranger, et un travail de deuil dans la mesure où il doit renoncer à produire une traduction parfaite. Plutôt que de se cantonner à l’alternative théorique opposant traduisible et intraduisible, il est plus judicieux de s’orienter vers une alternative pratique : celle de la fidélité et de la trahison. Finalement, on peut considérer la traduction comme une trahison créatrice de l’œuvre originale, et c’est ce qui fait la grandeur et le risque de cette tâche.
Un complément pour vos oreilles:
« Qu’est-ce que traduire ? » sur France Culture

[1] A. Berman, l’Epreuve de l’étranger, Paris, Gallimard, 1995.
[2] G. Steiner, Après Babel, Paris, Albin Michel, 1998.